Une inondation artificielle pour rétablir l'état naturel de la Saane
De nombreux débits d'eau résiduels sous les réservoirs sont constamment bas et nuisent aux habitats dynamiques et à l'écologie des eaux. Le projet "Gestion durable de la plaine inondable et de l'hydroélectricité" du Programme national de recherche "Retournement énergétique" (PNR 70) étudie comment les inondations artificielles peuvent contrer ce phénomène et contribuer à une production hydroélectrique plus respectueuse de l'environnement. Une première inondation s'est produite dans la Saane et les données sont évaluées. La ZHAW, l'EPFL et l'Eawag sont impliqués.
L'eau résiduelle constante dans la Saane à seulement 2,5 à 3,5 mètres cubes par seconde limite l'habitat dynamique et vivant de la rivière et de la plaine d'inondation. Les zones inondées adjacentes ne sont plus inondées et la dynamique naturelle de l'écoulement est également largement perdue. En règle générale, il en résulte une dynamique limitée du débit et de la charge du lit, ainsi que des habitats homogènes avec moins de biodiversité. La législation révisée sur la protection des eaux prévoit donc que de telles situations doivent être corrigées. Dans le même temps, la révolution énergétique exerce une nouvelle pression sur l'hydroélectricité, c'est-à-dire que l'on ne veut pas perdre trop d'eau des réservoirs sans production d'électricité.
Les 14 et 15 septembre 2016, une inondation artificielle a été déclenchée par la société d'approvisionnement en énergie Groupe-E au barrage de Rossens. Jusqu'à 200 mètres cubes d'eau par seconde, soit une centaine de fois plus que le débit régulier, ont été drainés. Le lit de la rivière a été lavé, la croissance des algues a été contenue, les zones alluviales ont été temporairement attachées et les bancs de gravier ont été déplacés.
Un groupe de projet de la ZHAW, de l'EPFL et de l'EAWAG utilise maintenant les données recueillies pour étudier les effets. Avant l'inondation artificielle, les pierres étaient équipées d'émetteurs et leurs mouvements étaient enregistrés. Des dispositifs de type sonar ont enregistré la vitesse d'écoulement et la profondeur de l'eau pendant la propagation de l'inondation. Les drones ont été utilisés pour surveiller la dynamique de l'eau pendant les inondations, mais aussi pour quantifier les changements et les déplacements des bancs de gravier et d'autres habitats. Enfin, avant, pendant et après les inondations, des échantillons d'insectes aquatiques et de communautés microbiennes ont été prélevés pour évaluer l'impact sur la biodiversité.
Les résultats sont comparés avec la faux naturelle afin d'améliorer notre compréhension des tests d'inondation en tant qu'outil de gestion pour la restauration des rivières.
Vidéo : Gestion durable des plaines inondables et de l'hydroélectricité (ZHAW)
Michael Döring, chef du groupe de recherche Ecohydrologie, Haute école spécialisée zurichoise - ZHAW
 Forschungsgruppe Ökohydrologie – ZHAW
Forschungsgruppe Ökohydrologie – ZHAW
 ShutterstockFernwärme hat in der Schweiz noch grosses Ausbau-Potenzial
ShutterstockFernwärme hat in der Schweiz noch grosses Ausbau-Potenzial  Sceptisisme européen au Motor Summit’16
Sceptisisme européen au Motor Summit’16  Thomas Lüthi, RingierKickstart 2019: Start-Ups sind ausgewählt
Thomas Lüthi, RingierKickstart 2019: Start-Ups sind ausgewählt 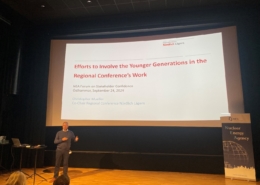 kup/BFEGeologische Tiefenlager: Beteiligung der Jugend in Schweden und der Schweiz
kup/BFEGeologische Tiefenlager: Beteiligung der Jugend in Schweden und der Schweiz 

 EPFL
EPFL
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!